« L’extrême droite et ses idées sont l’ennemi de la culture », « lorsqu’on travaille dans la culture, on est forcément en lutte permanente avec l’extrême droite, car quand elle arrive au pouvoir, elle frappe systématiquement sur la culture et la liberté d’expression », « Le monde des arts et de la culture (…) participe à la construction collective d’un avenir durable, vivable, désirable, plus juste. Autant de notions incompatibles avec les idées de l’extrême droite. » Ces trois verbatims, respectivement issus d’un tract de la CGT-Spectacle, du témoignage d’un photographe de spectacle lors d’une manifestation, et d’une pétition signée par 500 artistes de la musique avant les législatives anticipées de 2024 1, résument le consensus apparent au sein du secteur culturel. L’extrême droite est un ennemi irréductible et ontologique. Cependant, travailler en lien avec les centaines d’élu·es du Rassemblement National (RN), de Reconquête ou de l’Union des Droites pour la République (UDR) 2 et des personnalités dont on réprouve les idées est un dilemme très concret qui se pose pour de nombreux acteur·rices culturel·les. Nul doute que cela va le devenir encore plus dans les mois, les années à venir. Il semble donc intéressant d’examiner l’hypothèse sous-jacente, sans posture dogmatique a priori : que se passerait-il si ces deux mondes devaient œuvrer ensemble ?On est peut-être à un tournant des politiques culturelles en France
Le contexte politique et budgétaire actuel voit la remise en cause du soutien public à la culture et un détricotage assumé de la compétence partagée entre collectivités et État. En d’autres termes, le consensus transpartisan autour de la culture semble derrière nous, les financements croisés caractéristiques de ce système sont fragilisés et on est peut-être à un tournant des politiques culturelles en France 3. Dans une période où la question culturelle est largement désinvestie par le personnel politique, et le secteur culturel de plus en plus l’objet d’attaques de sa part, celui-ci a besoin d’allié·es dans le champ politique qui prennent fait et cause pour lui. Les quatre années à venir seront émaillées d’échéances électorales 4 et, sans préjuger d’un raz-de-marée de l’extrême droite comme aiment à prophétiser les médias, des collectivités et des positions de pouvoir risquent de basculer en sa faveur. En accord avec leur stratégie de normalisation, des élu·es d’extrême droite multiplient les signaux « rassurants » et les appels du pied aux acteur·rices culturel·les (généralisation des courriers de félicitations accompagnant l’octroi de subventions), électorat qui ne leur est clairement pas acquis. Ouvrir un dialogue avec ces élu.es apparaît donc tentant pour mieux cerner les intentions déguisées derrière ce qui est affiché, a fortiori en contexte électoral, pour faire levier auprès des autres formations politiques afin qu’elles réinvestissent les questions culturelles et répondent aux préoccupations des acteur·rices du secteur.
Avant d’en venir là, une double question s’impose : quelles sont les ambitions de l’extrême droite en matière culturelle, et comment cela se traduit une fois celle-ci arrivée au pouvoir ? Si l’on prend le cas du parti le plus emblématique en France, le RN, son programme pour les dernières élections présidentielles et européennes montre une certaine constance. Dans les faits, il contient peu de propositions en matière culturelle, si ce n’est en matière de sauvegarde du patrimoine, de défense de la francophonie et de privatisation de l’audiovisuel public. Dans le fond, elles traduisent une vision fortement identitaire, conservatrice et néolibérale de la culture. La politique publique de la culture n’est pas traitée comme un sujet à part entière par le RN, le parti n’étant pas historiquement lié à l’ensemble d’interventions, d’institutions et de valeurs qui l’incarnent. Mais les sujets culturels y sont considérés comme essentiels et plutôt traités via son tamis idéologique, comme l’observe Vincent Guillon, au travers des « thématiques du "grand remplacement", de "l’identité française", de la dépossession et de l’insécurité culturelles, des fondements religieux et historiques de la société, du déclin culturel et civilisationnel » 5.
La mise au pas autoritaire de la culture, qui vient d’emblée à l’esprit à l’évocation du RN, est-elle une généralité dans les exécutifs territoriaux contrôlés par ses élu·es ? Le politiste Emmanuel Négrier, qui s’est penché sur la question à l’aube des législatives anticipées de 2024, dessine un tableau plus nuancé. A partir de quelques cas de figure, il montre que « la folklorisation et le rejet de la diversité culturelle sont donc à la fois présents et discrets dans la gestion RN des villes » 6. Il l’explique par une volonté délibérée de ne pas faire de vague, en accord avec la stratégie de dédiabolisation du parti qui passe notamment par le fait de prouver la capacité du RN à gouverner en assumant une posture idéologique la plus neutre possible. Si l’extrême droite se faisait beaucoup plus interventionniste dans les grandes villes du Sud-Est conquises lors des municipales des années 1990, Vincent Guillon explique lui aussi que la séquence 2014-2020 ouvre la voie à une gestion municipale de la culture qui joue en majorité la carte de la respectabilité et la continuité des partenariats et soutiens culturels 7. Cela tient notamment au fait que la culture est moins considérée comme une priorité que d’autres secteurs tels que l’économie ou la sécurité. Cet interventionnisme diffus n’empêche pas l’affirmation de choix politiques :
rejet plus ou moins direct du soutien à certaines esthétiques (rap, techno), ou aux acteurs les plus investis dans l’éducation populaire et les quartiers prioritaires (éviction de la Ligue des Droits de l’Homme à Hénin-Beaumont), exacerbation d’une « identité française » et d’une histoire nationale et locale fantasmées (Fête du cochon à Hayange, célébration de l’Algérie française à Perpignan), reprise en main de programmation, dé-conventionnement et conflits avec des équipes artistiques (théâtre de l’Escapade à Hénin-Beaumont, Cie Arène Théâtre à Moissac)…
Il faut rappeler que l’extrême droite n’a pas le monopole des ingérences.
Il faut en revanche rappeler que l’extrême droite n’a pas le monopole des ingérences. Historiquement, les élu·es de tous bords ont interféré dans la conduite des affaires culturelles, et menacé l’autonomie de ses acteur·rices à divers degrés 8. Professionnel·les du secteur et élu·es se disputent régulièrement les frontières de leurs prérogatives. Cela se traduit par de vifs antagonismes 9, et par des atteintes à la liberté de création et de diffusion artistiques dont l’essor important ces dernières années a conduit à une alerte de la commission culture du Sénat en décembre 2024 10. En ce sens, l’extrême droite ne fait que reconduire des pratiques politiques existantes. On peut donc se demander pourquoi leurs ingérences défraient autant la chronique, si ce n’est leur caractère peut-être plus brutal et la focalisation médiatique forte.
Au demeurant, une inconnue de taille persiste : que feront les formations d’extrême droite une fois élues et qu’elles ne seront plus en quête de respectabilité ? L’exercice du pouvoir en Hongrie, en Italie ou en Pologne montre une certaine continuité, malgré des différences : culture mise au service d’une idéologie réactionnaire et d’un récit national revisité, mise au pas des services publics et/ou privatisation des filières par des grands groupes plus ou moins proches des gouvernements, autocensure structurelle des artistes et des institutions 11... Ces mesures d’inspiration fasciste 12 montrent que les logiciels idéologiques de l’extrême droite et des acteur·rices du secteur culturel sont insolubles, rendant toute forme de compromis impossible et tout rapprochement vain et périlleux.
Une fois la piste du rapprochement avec l’extrême droite écartée, quelles alternatives s’offrent à nous pour sortir de la sidération actuelle et faire face aux difficultés croissantes ? Il y a sûrement déjà un enjeu à acter le basculement du centre de gravité de l’échiquier politique vers des positions très conservatrices et réactionnaires, autrefois trustées par l’extrême droite. Autrement dit, ce sont peut-être moins les élu·es d’extrême droite qui constituent le danger que l’assimilation décomplexée de leurs idées par le champ politique. En témoignent particulièrement les politiques menées par les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire, sous l’impulsion de leur exécutif présidé par des élu·es Les Républicains et Horizons, qu’on peut résumer par le triptyque intimidations/coupes budgétaires/attaques idéologiques 13. L’erreur consisterait à y voir des cas isolés, quand cette porosité se retrouve dans la communauté de votes très forte à l’Assemblée nationale entre député·es des groupes Droite Républicaine (DR) et RN 14. Ce sont peut-être moins les élu·es d’extrême droite qui constituent le danger que l’assimilation décomplexée de leurs idées par le champ politique
Le fait que les attaques du secteur culturel, de ses valeurs et de ses acteur·rices, soient de plus en plus frontales, répétées et généralisées à un spectre politico-médiatique large appelle à agir en conséquence. L’ensemble des atteintes doivent être systématiquement documentées et dénoncées, leurs impacts mesurés, et les risques encourus médiatisés auprès du grand public.
Mais cela est insuffisant et demande aussi d’autres formes de réponses, plus réflexives. Il y a un enjeu majeur à (re)construire au sein du secteur culturel un discours et un positionnement face au narratif de l’extrême droite, qui soient audibles par le plus grand nombre et redonnent à la culture une image désirable, une volonté partagée de défendre ce secteur et ses acteur·rices. Si absurdes qu’ils puissent paraître à celles et ceux qui y travaillent, souvent dans la précarité, les discours assimilant le secteur culturel à une caste de privilégié·es vivant confortablement d’argent public semblent trouver un écho chez beaucoup de citoyen·nes. Probablement parce que l’image de déconnexion et d’entre-soi dont souffre le secteur a fait son chemin et achève de le rendre non essentiel dans l’opinion : à l’heure où les injonctions à tailler dans les services publics deviennent la norme, qu’est-ce qui justifierait en effet de préserver le financement de la culture au détriment de la santé ou de l’éducation ? Il y a ici un réel travail de fond pour réinventer un récit qui parle à la population dans sa diversité. C’est-à-dire qui ne se focalise pas sur la défense des emplois, sur les « dates en moins » ou sur la création artistique, mais incarne des thématiques qui touchent au quotidien des personnes pour rendre les attaques de la culture socialement inacceptables.
La réinvention de ce discours doit aussi permettre d’aller chercher les plus rétif·ves, du côté de l’électorat d’extrême droite. Le récent ouvrage du chercheur Félicien Faury montre que les ressorts du vote RN se caractérisent notamment par une dimension raciste et une détestation des élites culturelles, son électorat se sentant moins solidaire des personnes au fort capital culturel que des dominants économiques 15. La critique des « assisté·es » et la « valeur travail » étant prégnantes au sein de cet électorat, l’assimilation des acteur·rices culturel·les à une forme d’assistanat rencontre donc un écho particulièrement favorable chez lui. Le discours convenu sur la culture vectrice du vivre-ensemble et de diversité ne suffira plus à faire face en l’état actuel. Il serait plus porteur de jouer sur des affects communs (l’attachement aux services publics, une meilleure redistribution des richesses), des conditions de vie et des préoccupations quotidiennes partagées (la précarité, la crainte du déclassement), en les ramenant aux raccourcis trompeurs et aux faiblesses du discours social de l’extrême droite (la « préférence nationale » comme réponse).
Qui plus est, tenter de comprendre et de convaincre ne solutionnera pas tout. Ce serait se cantonner à une posture de « sachant » et sous-tend que les « autres » ont tort alors que nous sommes dans le vrai, des raisons alimentant en partie la défiance de l’électorat d’extrême droite 16. Et cela conduirait à éloigner toute tentative d’introspection, qui paraît aujourd’hui nécessaire à au moins deux égards : prendre acte du fait que la culture, telle que nous la mettons en œuvre, ne parle pas à tous·tes et que nous avons une responsabilité ; réexaminer en conséquence ce qu’on propose et la conception de la politique publique de la culture qui la sous-tend. Prendre acte du fait que la culture, telle que nous la mettons en œuvre, ne parle pas à tous·tes et que nous avons une responsabilité
A la suite des travaux pionniers de Pierre Bourdieu, les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français nous enseignent depuis plusieurs décennies que la stratification sociale perdure malgré des inflexions. En dépit d’une diversification de l’offre et de l’essor global des sorties culturelles, la fréquentation des lieux culturels demeure plus souvent le fait des catégories supérieures urbaines diplômées et de publics vieillissants 17. Quand on sait que 3 % de la population seulement a un abonnement a une salle de spectacle 18, est-ce qu’on peut considérer que nous sommes irréprochables ou que nous ne pouvons pas mieux faire ? Armé·es des meilleures intentions, sincèrement convaincu·es du bien-fondé de notre action et ne ménageant pas nos efforts, nous laissons tout de même la majeure partie de la population de côté. Il y a là un énorme paradoxe quand on revendique s’adresser à tous·tes, doxa des professionnel·les de la culture.
Comme le rappelle fréquemment le sociologue Fabrice Raffin, l’échec de la démocratisation culturelle est consommé, et celle-ci a longtemps servi d’alibi à la production d’une culture institutionnelle pour l’essentiel définie par les professionnel·les de ces institutions et leurs publics attitrés 19. Un nombre considérable de personnes issues de milieux populaires ou de classes moyennes ont la conviction chevillée au corps que cette culture n'est pas faite « pour eux », et ne voient pas l’intérêt de fréquenter des lieux et des événements culturels 20. Peut-on se contenter de leur dire que le « monde des arts et de la culture est en prise directe avec la société et ses évolutions [et] participe à la construction collective d’un avenir durable, vivable, désirable, plus juste » 21 ? Ou doit-on chercher à incarner cette diversité autrement et refonder un pacte de confiance ?
D’autres pratiques et attentes en matière culturelle doivent être prises en considération sous peine d’alimenter des ressentiments et d’éloigner encore davantage une partie de la population de la vie démocratique 22. Le recul historique suggère que ce n’est pas (qu’) une question de manque de moyens, d’accès aux équipements ou de médiation insuffisante, dans la mesure où ces tentatives d’ouverture se révèlent au mieux peu fructueuses, au pire contre-productives 23.
Si les constats sur la crise de la culture ne datent pas d’hier et sont souvent instrumentalisés 24, un ensemble de marqueurs montrent clairement une polycrise profonde à l’œuvre (des financements, des publics, de sens). Et les réponses jusqu’à présent ne sont pas à la hauteur des défis, comme l’a révélé la séquence ouverte par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024. Absence de remise en question sérieuse des milieux culturels 25, positionnements pas définis voire clivés vis-à-vis de l’extrême droite 26, mobilisation balbutiante et dispersée pour faire face aux attaques diverses sur le monde associatif 27, discours de défense du secteur culturel qui peine à trouver ses arguments, soutien des concitoyen·nes introuvable en raison d’une assise auprès des classes moyennes et populaires qui n’a cessé de diminuer depuis les années 1970 28, parole politique longtemps inaudible 29,… Ces dynamiques tiennent en partie à une double tendance à l’œuvre depuis des décennies, qui participe à l’atomisation du secteur culturel et entrave sa capacité à être en prise avec la société : la montée en puissance d’une conception libérale de la culture, qui se traduit entre autres par des politiques de soutien à des « filières culturelles » (en grande partie envisagées sous un prisme économique et par des appels à projets toujours plus prégnants) ; la dépolitisation des artistes et des professionnel·les de la culture, illustrée par l’atonie des milieux culturels à l’été 2024, qui a conduit à une mobilisation tardive et inégale pour les législatives anticipées 30.
Le monde de la culture se fantasme en rempart contre la barbarie, alors qu’il a du mal aujourd’hui ne serait-ce qu’à se coaliser et à fédérer autour de lui. Le centre de gravité des réflexions et mobilisations actuelles devrait moins tourner autour du « comment on sauve nos activités et nos emplois » que du « comment on renoue avec le corps social, pour qu’il nous aide à sauver nos activités et nos emplois ». Dit autrement, il faut peut-être tenir stratégiquement deux bouts ensemble : rappeler avec force à quoi sert la culture et la valeur créée pour la société, et remettre à plat collectivement notre modèle en bout de course pour faire en sorte que chacun·e regagne en pouvoir sur sa vie culturelle. Le monde de la culture se fantasme en rempart contre la barbarie, alors qu’il a du mal aujourd’hui ne serait-ce qu’à se coaliser et à fédérer autour de lui
Ce second chantier doit impérativement se faire avec les citoyen·nes, pas « en leur nom ». A défaut, le risque est grand de le cantonner à des enjeux politico-administratifs et à des ajustements à la marge décidés par une minorité, au lieu d’en faire une question sociale et un objet de débat public. C’est pourtant l’écueil qui guette les récentes initiatives en ce sens, malgré un constat commun sur le besoin de refonder les politiques culturelles : appel de Culture·Co à des Assises nationales de la culture et préparation par ses adhérents d’une position nationale sur l’avenir des politiques culturelles territoriales, travaux de la commission Culture de Régions de France pour aboutir à la construction de propositions nouvelles 31, appels divers à réinventer le service public de la culture 32, appel à des États généraux de la culture initié par le Parti Communiste Français 33...
On voit mal comment les préoccupations et aspirations citoyennes vont infuser dans ces espaces qui fleurent l’entre-soi « expert », alors que cela devrait être un prérequis. L’organisation d’une Convention citoyenne de la culture, récemment proposée par le Syndicat national des arts vivants (Synavi) 34, aurait au moins ce mérite-là – malgré toutes les limites des Conventions citoyennes. Les questions à trancher sont nombreuses et nous concernent tous·tes au premier chef : que choisit-on de soutenir (ou non) et à quel degré, de sanctuariser (la culture comme compétence obligatoire par exemple), qui prend en charge quoi parmi les collectivités locales et l’Etat, quelle répartition des financements au sein du secteur pour asseoir au mieux la diversité artistique et culturelle, quelle place de la création artistique subventionnée – historiquement survalorisée en France – par rapport aux autres missions de service public, quels outils et moyens pour asseoir une culture au service de l’émancipation de chacun·e et de la justice sociale, etc.
Un des cadres possibles pour repenser ce modèle culturel en déclin est celui des droits culturels. Alors que cette notion est consacrée par deux lois depuis une décennie (NOTRe en 2015 et LCAP en 2016), elle n’a jamais permis de redessiner la politique culturelle française 35. Si le manque de volontarisme politique est en cause, la méconnaissance et l’absence de mise en pratique par les responsables culturel·les 36, voire leurs résistances parfois très fortes 37, font partie du problème. Le résultat : au moment où nous nous battons pour ne pas prendre l’eau et où le ministère de la Culture alloue péniblement 6 millions d’euros (ME) supplémentaires au plan « Mieux produire, mieux diffuser » (après avoir consenti une baisse de 114 ME sur son budget 2025), l’Espagne lance un ambitieux Plan pour les droits culturels issu d’une année de concertations, en le dotant de 79 ME et en créant une direction des droits culturels au sein de son ministère de la Culture. Au risque de rappeler une évidence, il ne suffit pas de faire des « hors les murs » ou des « scènes ouvertes » pour concrétiser les droits culturels. Cela requiert de réinventer des rôles et des fonctions souvent « sacro-saints » (création, programmation et diffusion), en reconsidérant le monopole des professionnel·les sur la prescription culturelle 38. Et, plus profondément, de se départir d’une conception de la « culture-catalogue » (aménager un « déjà-là » institué en mettant les œuvres d’art au centre) au profit d’une « culture-processus », consistant à mettre les relations entre personnes et autres vivants au cœur, pour décider continuellement ce qui « fait culture » dans le respect de la liberté et de l’égalité de chacun·e 39. Une piste ardue bien que prometteuse, face aux visions autoritaires et liberticides de la culture véhiculées par un nombre croissant d’élu·es, et aux impasses décrites qui font de la culture un vecteur d’exclusion et de ressentiment. Cet exercice d’introspection individuel et collectif pourrait être le prix de l’alternative au pacte faustien, et contribuer à la préservation de ce qui nous anime.



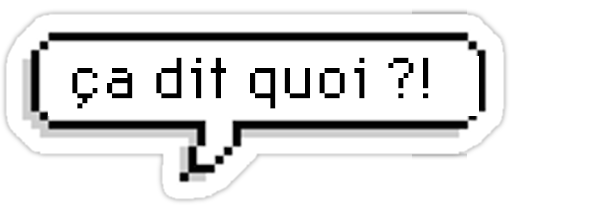
 je signale ce sujet comme particulièrement important pour moi !
je signale ce sujet comme particulièrement important pour moi ! 




 5 rue J-R. Degrève – 59260 Hellemmes Lille / 10h à 17h
5 rue J-R. Degrève – 59260 Hellemmes Lille / 10h à 17h